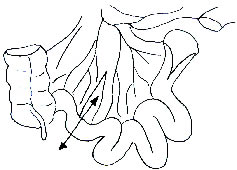
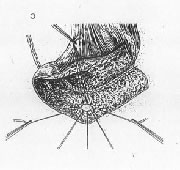
Sommaire
Définition
et indications
Principes généraux et techniques
Préparation
Protocole opératoire
Suites opératoires immédiates
Complications
per et post-opératoires immédiates
Complications à distance de l'intervention
Conseils aux patients
Après ablation de la vessie (cystectomie) les urines fabriquées par les reins doivent être évacuées. Selon les cas, il sera nécessaire d'envisager une dérivation à la peau en réalisant un ou deux orifices sur la paroi abdominale antérieure (stomie urinaire), plus rarement en dérivant les urines dans le colon. Parfois il est possible d'envisager de faire une néo-vessie et rétablir l'évacuation des urines par le canal urétral: on parle alors de remplacement de vessie ou entérocystoplastie ("entero" car on utilise pour ce faire de l'intestin).
La mise au point et l'amélioration des techniques de remplacement de vessie chez l'homme et depuis peu maintenant envisagée chez la femme, ont rendu le recours aux dérivations cutanées ou dans le colon de ce fait moins fréquent.
Ces remplacements vésicaux restent toutefois contre-indiqués lorsqu’il existe une atteinte du col de la vessie ou de l’urètre, ou chez des patients dont l’état général ne permet pas une intervention relativement lourde.
La cystectomie avec remplacement s'adresse donc surtout aux patients porteurs d'un cancer de vessie ou d'une papillomatose vésicale récidivante avec un bilan d ’extension de la maladie négatif (pas de métastases) et en bon état général.
PRINCIPES GENERAUX ET TECHNIQUES
Le principe de l'intervention est de confectionner un réservoir reproduisant au maximum les propriétés de la vessie normale et permettant au patient de vivre sur le plan urinaire aussi normalement que possible. Toutes les techniques utilisent comme matériel pour faire ce néo-réservoir de l'intestin, grèle plus plus souvent, parfois colique et enfin plus rarement composite à savoir grêle et colon.
De nombreuses techniques de remplacement vésical ont été décrites et sont pratiquées : je citerais essentiellement l’entérocystoplastie type Camey 2, ou type Hautman. Leur principe est de confectionner avec un segment intestinal, un réservoir à basse pression en détubulisant le greffon intestinal. Dans ce réservoir seront implantés les uretères en utilisant un procédé anti-reflux et l’entérocystoplastie sera ensuite raccordée par une suture à l’urètre.
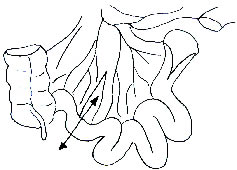 |
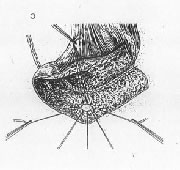 |
|
Prélèvement
d'un segment d'intestin grêle |
Schéma
d'une entérocystoplastie de remplacement type Hautman |
Schéma
d'une entérocystoplastie de remplacement type Camey II |
Une consultation d'anesthésie est indispensable comme pour
toute intervention programmée, dans le mois qui précède
l'intervention.
Il est également hautement recommandé d'effectuer
un repérage d'un éventuel site de stomie urinaire dans les jours
précédents l'intervention dans l'hypothèse ou le remplacement
de la vessie s'avère impossible en per-opératoire du fait de difficultés
anatomiques, techniques ou carcinologiques. Une consultation avec la stomathérapeute
est donc hautement souhaitable avant l'hospitalisation.
Avant l'intervention on vérifiera l'absence d'infection urinaire
par une analyse d'urine (ECBU).
Une préparation intestinale sera souvent effectuée
par un régime sans résidu mis en route quelques jours avant l'intervention
et/ou par un lavement évacuateur le veille.
Un rasage de l'abdomen et du pubis est effectué la veille
de l'intervention, une douche antiseptique est également demandée
la veille ou le matin de l'intervention.
L'intervention
se déroule sous anesthésie générale et se fait le
plus souvent par une incision médiane, entre l'ombilic et le pubis. Parfois
d'autres incisions sont possibles.
Selon les cas, un curage ganglionnaire au niveau iliaque (curage
ganglionnaire) est effectué en début d'intervention pour vérifier
l'absence d'atteinte métastatique de ces ganglions.
L'intervention consiste ensuite à retirer la vessie, la prostate
et les vésicules séminales chez l'homme, puis à prélever
un segment d'intestin que l'on isole du circuit digestif et que l'on modèle
de façon à obtenir un réservoir dans lequel seront raccordés
les urétères, réservoir qui sera ensuite raccordé
à l'urètre pour rétablir le circuit urinaire.
Une sonde vésicale est placé dans l'urètre
jusqu'au réservoir intestinal, chacun des uretères est intubé
par une sonde urétérale qui remonte dans chaque rein et sort de
chaque côté à travers la néo-vessie puis la paroi
de l'abdomen, deux petits drains aspiratifs sont habituellement placés
dans la cavité pelvienne. En plus des diverses sondes liées à
l'intervention, une sonde gastrique est habituellement laissée jusqu'à
la reprise du transit des gaz intestinaux ainsi qu'une perfusion jusqu'à
la reprise de l'alimentation.
Comme après toute incision, des douleurs au niveau de la paroi de l'abdomen sont fréquentes pendant les jours suivants l'intervention. Un traitement anti-inflammatoire et antalgique est alors prescrit par voie intra-veineuse initialement, puis per os. Dans certains cas on peut utiliser des pompes à morphine, dispositif installé sur la perfusion et qui permet par une impulsion donnée par le patient lui-même sur une petite poire-interrupteur, de délivrer une dose fixe de morphine. Ce dispositif est muni d'un contrôle qui limite la dose délivrée à un certain seuil horaire.
Un traitement anticoagulant à dose préventive par injection quotidienne sous-cutanée d'un dérivé de l'héparine est indispensable et sera habituellement poursuivi au retour du patient à son domicile pendant plusieurs jours. Ce traitement peut être complété par des bas de contention veineuse mis en place avant même le début de l'intervention.
Jusqu'à
la reprise du transit intestinal, l'apport des liquides est assuré par
le catheter intra-veineux (perfusion).
Une fois le retour des gazs évacués par l'anus,
la sonde gastrique sera ôtée et la reprise de l'alimentation se
fera progressivement.
Très régulièrement de petits lavages par du serum physiologique seront effectués par la sonde vésicale afin d'éliminer le mucus produit par la muqueuse intestinale ayant servi à réaliser le néo-réservoir vésical.
Les drains aspiratifs seront ôtés dès leur débit faible. Parfois l'écoulement de d'urine ou de lymphe peut persister et devenir abondant. Dans ce cas, le vide peut être retiré du flacon de recueil et le drain mis en débit libre afin de permettre son ablation dès le débit ralenti et pratiquement tarit. Cette ablation peut parfois n'être possible qu'au bout de plusieurs jours, parfois plus d'une semaine.
Les
sondes urétérales sont ôtés l'une après l'autre
entre 10 et 15 jours après avoir habituellement vérifié
l'étanchéité du réservoir vésical en injectant
prudemment sous contrôle radiologique du produit de contraste par la sonde
vésicale.
La sonde vésicale est ensuite retirée (entre
le 12 et 20 ème jour). La reprise des mictions se fait alors par voie
naturelle mais il est fréquent d'avoir dans les premiers temps des difficultés
à pouvoir se retenir ou des fuites à l'effort surtout. Une auto-rééducation
sera apprise au patient pour accélérer la récupération
du sphincter mais sans être trop précoce afin d'attendre une cicatrisation
minimum des sutures.
L'ablation des fils et agrafes se fait entre 7 et 10 jours habituellement.
Le patient peut s'assoir au lit dès le lendemain, puis est levé au fauteuil le surlendemain (pour limiter le risque de phlébite, faciliter la reprise du transit,..).La sortie est habituellement possible entre 2 et 3 semaines après l'intervention. Après la sortie, une période de convalescence est nécessaire, variable selon les suites opératoires, l'âge, mais se situe en général entre 2 et 3 mois. La reprise d'une activité physique sportive ne pourra s'envisager qu'après 3mois.
COMPLICATIONS PER ET POST-OPERATOIRES IMMEDIATES (Pendant l'intervention et l'hospitalisation)
-
risque de plaie du rectum pendant l’intervention. Très rare, cette plaie
est alors suturée pendant l’intervention. Elle peut exceptionnellement
nécessiter la confection d’un anus artificiel provisoire pour permettre
sa cicatrisation. 0,2 à 9 %.
- hémorragie pendant l'intervention. Elle nécessite
rarement une transfusion. Le plus souvent si le saignement a été
important, la prescription d'une supplémentation en fer accélérera
la récupération d'un taux d'hémoglobine normal.
- hématome pelvien. Il va habituellement spontanément
se résorber, mais important il pourra nécessiter une réintervention
pour être évacué.
- fistule digestive: fuite de liquide intestinal par la cicatrice.
Cette complication nécessite le maintien d'une aspiration digestive,
parfois une réintervention pour refermer la fistule, refaire l'anastomose,
rarement dériver transitoirement à la peau le circuit digestif
(stomie digestive).
- occlusion intestinale: se traduisant par la non reprise
du transit intestinal, un ballonement abdominal, elle justifie le maintien de
l'aspiration digestive et parfois une réintervention pour supprimer la
cause de l'obstruction (occlusion sur bride par exemple).
-
infection urinaire. Elle est systématiquement recherchée une fois
la sonde retirée et traitée par antibiotique si nécessaire.
- abcès de paroi sur la cicatrice. Il nécessite
alors le plus souvent des soins locaux, parfois des antibiotiques et exceptionnellement
une intervention pour être évacué.
- éviscération: lachâge de la fermeture
de la paroi abdominale. Complication rares, liées souvent à une
complication intra-abdominale, elle impose une reprise chirurgicale en urgence.
- fistule urinaire par les drains aspiratifs: les drains et
la sonde urinaire seront alors laissés plus longtemps, le vide des drains
aspiratifs pourra être retiré pour faciliter la fermeture de la
communication entre la suture et le drain et aider la cicatrisation de cette
fistule.
- lymphorrhée: écoulement de lymphe par les
drains aspiratifs. Cet écoulement doit être différencié
un écoulement d'urine mais en pratique l'attitude sera voisine, à
savoir le maintien du drainage. Une fois les drains retirés, peut se
produire une collection de lymphe au niveau des curages ganglionnaires: il s'agit
d'une lymphocèle. Cette collection nécessite rarement une réintervention
pour être drainée, parfois une ponction sera suffisante lorsqu'un
geste est nécessaire.
- phlébite et embolie pulmonaire: 1 à 7 %
- infections nosocomiales: infections à certains germes,
souvent résistants, contractées à l'hôpital. Ces
infections peuvent intéresser le site opératoire, le reste de
l'appareil urinaire, les poumons, les cathéters intra-veineux,… Le taux
d'infection nosocomiale est globalement de l'ordre de 6 à 7 % tous services
et toute pathologie confondue (enquête de prévalence sur une journée
en 1996).
- comme pour tout acte chirurgical, certaines complications
imprévisibles parfois mortelles peuvent s'observer tenant à des
variations individuelles parfois imprévisibles, à l'âge,
à la pathologie présentée. Lors de l'intervention un évènement
ou des constatations imprévues pourront modifier le déroulement
de l'intervention et faire envisager un ou plusieurs gestes non prévus
initialement.
COMPLICATIONS A DISTANCE DE L'INTERVENTION
-
risque de lymphocèle (collection de liquide lymphatique au niveau des
ganglions prélevés de chaque côté du petit bassin).
1 à 6 %. Cette collection nécessite rarement une réintervention
pour être drainée, parfois une ponction sera suffisante lorsqu'un
geste est nécessaire.
- risque d'éventration de la paroi surtout sur ses
extrémités (au-dessus du pubis, ou au contraire près de
l'ombilic). Une intervention peut alors être nécessaire.
- sténoses des réimplantations urétérales
dans le néo-réservoir vésical. Elles seront systématiquement
recherchées lors de la surveillance par des échographies et éventuellement
urographies régulière. Leur survenue peut justifier un geste chirurgicale
par voie endoscopique ou par chirurgie à ciel ouvert.
-
incontinence urinaire: elle est le plus souvent régressive dans la journée,
mais peut persister la nuit. Elle oblige alors le patient à devoir se
lever à intervalles réguliers pour vider son réservoir
vésical. Elle peut justifier la prescription d'une rééducation
sphinctérienne et plus exceptionnellement la mise en place d'un sphincter
artificiel.
- impuissance: complication fréquente après
une cystectomie, elle nécessitera selon les cas une prise en charge psychologique
et pharmacologique (auto-injection intra-cerverneuse, sildénafil,..).
- rétention par accumulation de mucus: le réservoir
vésical étant constitué de paroi intestinale, celle-ci
sécrète du mucus qui est éliminé avec les urines.
Celles-ci contiennent donc des filaments ou particules floconneuses éliminées
lors de la miction. Pour éviter leur accumulation et donc le risque qu'elles
obstruent l'urètre, il est important de maintenir une diurèse
et donc un apport de boisson suffisant pour permettre leur élimination
régulièrement.
- troubles métaboliques: le contact des urines sur
la paroi du réservoir vésical, formé par une muqueuse intestinale,
va entraîner des phénomènes de réabsorption de certains
constituants de l'urine qui peuvent à moyen terme aboutir à des
désordres métaboliques (acidose métabolique). Leur prévention
consistera en l'absorption régulière d'eau de Vichy qui permet
une alcalinisation des urines et limite ce phénomène, et en une
bonne éducation des patients afin de limiter le temps de contact des
urines avec la muqueuse néo-vésicale en vidant bien régulièrement
leur réservoir et en évitant sa distension progressive.
-
risques plus tardifs de rétrécissement de l'urètre ou de
l'anastomose entre vessie et urètre. Il peut être nécessaire
d'intervenir par voie endoscopique pour inciser ce rétrécissement
avec malgré tout un risque de voir apparaître ou réapparaître
alors une incontinence d'urine.
-
enfin s'agissant d'une pathologie le plus souvent tumorale, une fois la pièce
opératoire retirée, elle est examinée au microscope afin
de vérifier les limites de la tumeur. Lorsqu'il existe un risque de récidive
locale ou métastatique du fait d'une extension importante de la tumeur
localement, un traitement complémentaire par radiothérapie et/ou
chimiothérapie peut être nécessaire. Il existe également
un risque de récidive de la tumeur, plus tardive et qui justifie une
surveillance régulière pendant les années suivant l'intervention.
La sensation de besoin n'existe plus après une entérocystoplastie. Il est donc indispensable de bien expliquer aux patients la nécessité de vider régulièrement leur néo-vessie. En effet en l'absence de sensation de besoin (parfois remplacée par une sensation de "plénitude" pelvienne), le réservoir néo-vésical peut progressivement se distendre et voire sa capacité augmenter anormalement par distension progressive. La vidange se fait en s'aidant par une poussée abdominale et avec une bonne décontraction périnale.
Il est important de boire régulièrement pour éviter l'accumulation de mucus dans le néo-réservoir et limiter le risque d'infection urinaire. Un apport d'environ 1,5 litre par jour est recommandé en buvant régulièrement environ 1/4 à 1/2 litre d'eau de Vichy par jour pour alcaliniser les urines.
Une surveillance régulière est nécessaire sur un rythme variable selon les pathologies, les patients et les opérateurs. Habituellement, un examen biologique sanguin, une échographie rénale et de la néo-vessie sont pratiqués tous les semestres puis tous les ans. Si l'ablation de la vessie est liée à un cancer de vessie, des examens spécifiques pour vérifier l'absence de récidive locale ou métastatiques seront effectués (scanner, radiographie thoracique,..).
Télécharger la fiche d'information de l' AFU
Docteur B. d'ACREMONT - Mise à jour 7 février 2010