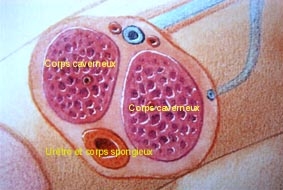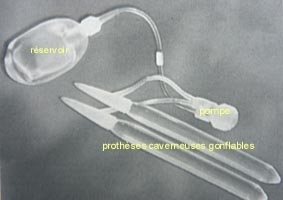L'INSUFFISANCE
ERECTILE (IMPUISSANCE)
Sommaire
Introduction
Mécanismes de l'érection
Causes des dysérections
Examens complémentaires
Traitements:
- pharmacologiques:
. traitements
médicamenteux injectables
. traitement médicamenteux
par voie urétrale
. traitements
pharmacologiques par voie orale
- le vacuum.
- la psychothérapie
- la chirurgie
Conclusions
Illustrations
INTRODUCTION
L’insuffisance érectile (encore appelée impuissance) est l’impossibilité
pour l’homme d’obtenir ou de maintenir une érection permettant le déroulement
d’un rapport sexuel satisfait.
L’insuffisance érectile n’est pas la seule affection sexuelle. En effet
elle se distingue des troubles de la libido, des troubles de l’éjaculation
(précoce ou tardive), des troubles de l’orgasme. Ces différentes
perturbations peuvent parfois s’associer entre elles. Elles sont vécues
comme une situation d’échec qui souvent entretien le dysfonctionnement
et peut avoir un retentissement psychique parfois sévère (perte
de confiance en soi, dépression,..).
L’insuffisance érectile est un trouble fréquent, dont l’incidence
augmente avec l’âge, touchant presque un homme sur 3 à 4 à
partir de 60 ans selon les études.
Cette pathologie restée longtemps tabou, a été fortement
médiatisée par la mise sur le marché en 1998 du sildénafil
(Viagra ®) qui en a «révolutionné» le traitement,
ouvrant également des perspectives thérapeutiques nouvelles.
Sommaire
MECANISMES
DE L'ERECTION:
L’érection est un phénomène encore mal connu, complexe,
associant des mécanismes vasculaires et tissulaires.
Les organes érectiles sont représentés par :
- les corps caverneux, au nombre de 2, de part et d’autre
et au-dessus de l’urètre, ils sont constitués d’un tissu musculaire
et vasculaire érectile dont l’action entraînera la tumescence,
et d’une enveloppe externe peu élastique, solide, l’albuginée,
dont la mise en tension va entraîner la rigidité en fin de tumescence.
- et le corps spongieux qui entoure l’urètre
et forme à l’extrémité du pénis le gland. Il constitué
également du même tissu érectile.
L’érection se déclenche à la suite d’une stimulation mais
survient également de façon normale, sans aucune stimulation la
nuit. Ces érections nocturnes sont normales et sont rythmées par
les cycles du sommeil. Elles sont également fréquentes le matin
au réveil.
Le tissu érectile, est constitué d’un réseau vasculaire
(espaces sinusoïdes) entouré par des fibres musculaires lisses.
A l’état de repos, la contraction permanente des fibres musculaires lisses
sous l’influence du système nerveux végétatif sympathique,
maintient les sinus vasculaires vides.
A la suite d’une stimulation, il se produit une relaxation des fibres musculaires
lisses et une dilatation des artères péniennes entraînant
le remplissage des espaces sinusoïdes. Les veines péniennes qui
assurent le retour du sang veineux et qui sont situées à la périphérie
des corps caverneux vont se trouver progressivement comprimées contre
l’albuginée. Le sang va donc se retrouver prisonnier des espaces sinusoïdes
et la pression dans les corps caverneux va ainsi augmenter entraînant
la rigidité une fois la limite d’élasticité de l’albuginée
atteinte.
La stimulation qu’elle soit visuelle, tactile entraîne une réaction
en chaîne, inconsciente, mettant en jeux des mécanismes nerveux
centraux, le système parasympathique qui est stimulé, le système
sympathique qui est au contraire inhibé. L’ensemble des actions entraînées
par ces systèmes nerveux chemine par des nerfs aboutissant aux pénis.
Dans le tissu érectile, ces fibres nerveuses entraînent la libération
de substances comme le monoxyde d’azote, qui va par une série de réactions
chimiques, relâcher les fibres musculaires lisses et permettre le déclenchement
et le maintien de l’érection.
Sommaire
CAUSES
DES DYSERECTIONS
La cause principale est psychologique (encore appelée fonctionnelle,
psychogène) qui peut être seule responsable du trouble sexuel mais
qui s’associe souvent aux éventuelles causes organiques, venant amplifier
leur retentissement réel sur l’érection. La frontière entre
les causes psychogènes et les causes organiques est donc très
difficile à faire.
Une dysérection peut s’expliquer par :
- une cause vasculaire : oblitération des artères vascularisant
les corps caverneux (athérosclérose) favorisée par le tabac,
l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie.
- Une cause toxique ou médicamenteuse : tabac, stupéfiants,
alcool, certains anti-hypertenseurs, psychotropes (neuroleptiques), analogues
de la LH-RH utilisés sans le traitement du cancer de prostate.
- Une cause homonale : hypogonadisme soit un déficit
de production de la testostérone par les testicules, hyperprolactinémie
(hormone sécrétée par l’hypophyse en quantité anormale
soit par l’existence d’une tumeur, ou lors de la prise de certains médicaments).
- Une cause neurologique : dans certaines maladies du système
nerveux central (maladie de Parkinson, certaines psychoses, sclérose
en plaque, ..) ou par altération des nerfs périphériques
par exemple lors de certaines interventions pelviennes comme la prostatectomie,
la cystectomie ou l’amputation abdomino-pelvienne pour cancer, ou de par l’effet
d’une radiothérapie pelvienne, mais également dans le diabète.
- Une cause tissulaire par fibrose du tissu érectile
après traumatisme, priapisme, plus rarement dans la maladie de
La Peyronie.
- Une cause métabolique : l’insuffisance érectile
est alors souvent multifactorielle comme dans le diabète, l’insuffisance
rénale chronique,..
- Enfin les causes psychogène : toutes les situations
de stress, d’échec, d’anxiété (qu’elles soient conjugales,
professionnelles, familiales,..) peuvent avoir pour conséquence des difficultés
sexuelles.
Sommaire
EXAMENS
COMPLEMENTAIRES
Ils peuvent être prescrits en complément de la consultation qui
reste l’élément essentiel de la prise en charge d’un trouble sexuel.
Cette consultation à pour but de préciser la nature du trouble
sexuel (trouble de la libido, de l’érection, de l’éjaculation),
son retentissement et la motivation du patient, les éventuelles étiologies.
Elle doit donc comprendre un interrogatoire et un examen clinique complet.
Elle pourra être complétée par :
- un dosage de testostérone et de prolactine.
- un échodoppler pénien : examen enregistrant
les flux vasculaires au niveau des artères péniennes réalisé
le plus souvent avec une injection intra-caverneuse d’un produit améliorant
la perfusion des corps caverneux (prostaglandine).
- plus rarement des explorations neuro-physiologiques.
Sommaire
TRAITEMENTS
PHARMACOLOGIQUES
- quelque soit le type de traitement, il n’est pas exceptionnel d’observer qu’après
une phase de traitement pharmacologique notamment, réapparaissent des
érections spontanées et que le traitement ne soit plus nécessaire.
- traitement médicamenteux par voie injectable:
les auto-injections ont été longtemps le seul traitement pharmacologique
des insuffisances érectiles mais malgré l’arrivée de nouvelles
molécules agissant par voie orale, elles gardent une place dans les possibilités
de traitement des dysérections.
. elles consistent pour le patient à se faire une injection dans la
verge, au niveau d’un corps canerveux, d’une solution contenant un produit
susceptible de déclencher à lui seul le plus souvent une érection
(sauf pour le moxisylyte). Cette érection apparaît dans les 5
à 15 minutes qui suivent l’injection.
. différentes substances
peuvent être utilisées : un alpha-bloquant, le moxisylyte (Icavex®)
ou une prostaglandine, l’alprostadil (Edex®, Caverject®)
. ce type de traitement nécessite
un apprentissage et la quantité administrée doit être
adaptée à chaque cas particulier, en augmentant la dose progressivement.
. en effet le risque principal
des auto-injections est celui du priapisme, érection prolongée
et douloureuse, persistant plus de 4 heures après l’injection. Elle
fait courir alors le risque d’une fibrose définitive et irréversible
des corps caverneux. C’est donc une urgence thérapeutique. L’activité
physique, une éjaculation peuvent suffire à faire disparaître
cette érection anormale, dans le cas contraire un traitement urgent
s’impose : injection intra-caverneuse d’un antidote (Effortyl®), ponction-lavage
des corps caverneux, exceptionnellement traitement chirurgical. La mise en
route d’un tel traitement impose donc de communiquer au patient un numéro
d’appel d’urgence.
. en dehors de ce risque principal,
les injections IC de prostaglandines peuvent entraîner une douleur lors
de l’érection. Il est possible également de voir apparaître
des nodules fibreux, parfois une déviation de la verge du fait de cette
fibrose.
. ces injections ne sont actuellement
pas remboursées sauf pour certaines affections de longue durée
(diabète, suites de prostatectomie radicale pour cancer, neuropathies).
Sommaire
- traitement médicamenteux par voie intra-urétrale:
. il utilise une prostaglandine, l’alprostadyl. Muse® (250, 500 ou 1000
microgrammes) et plus récemment Vitaros® 300 microgrammes administrée
sous forme d’une lotion par un bâton dans les premiers centimètres
de l’urètre pénien pour Muse® et sous forme de crème
déposée au méat urétral pour Vitaros®.
. il existe comme avec les
auto-injections un risque d’érection prolongée mais plus faible.
De même une douleur lors de l’érection peut également
être observée.
. les prostaglandines ayant
un effet abortif, elles ne peuvent être utilisées en intra-urétral
qu'avec une partenaire ménopausée ou sous contraception efficace.
. ce traitement n’est également
pas remboursé sauf pour le Vitaros® dans seulement dans certaines
indications (après chirurgie pelvienne lourde,...) et sur des ordonnances
de médicaments d'exception.
Sommaire
- traitements médicamenteux, par voie orale
:
. yohimbine, médicament ancien administré par voie orale et
en traitement continu sur plusieurs semaines ou mois. Elle doit être
utilisée avec prudence chez les patients souffrant de problèmes
cardio-vasculaires. Elle est disponible sous deux formes différemment
dosées : Yohimbine Houdé ®, Yocoral®
. sildénafil (Viagra®)
médicament agissant sur la voie d’action du monoxyde d’azote au niveau
du tissu érectile.
Agissant environ 40 à 60 mn après sa prise par voie orale, il
facilite l’apparition de l’érection et son maintien mais ne peut suffire
à lui seul à déclencher une érection.
Il est contre-indiqué dans certaines affections cardio-vasculaires
et en associant avec différents médicaments utilisés
dans l’angine de poitrine, surtout les dérivés nitrés
et les médicaments agissant sur la libération du monoxyde d’azote.
Il peut parfois donner des maux de tête, une sensation de bouffées
de chaleur, une rougeur de la face, des troubles de la vision des couleurs.
Il est délivré par 4 ou 8 comprimés à un dosage
unitaire de 25, 50 ou 100 mg et n’est pas remboursé par la sécurité
sociale (côut d’environ 10 euros le comprimé).
. tadalafil (Cialis®),
inhibiteur de la la phosphodiestérase. Il agit par prise orale dès
la première demi-heure et reste efficace pendant 24 à 36 heures.
Il est disponible sous forme 10 ou 20 mg et la posologie ne doit pas dépasser
un comprimé par jour. Comme le Viagra®, il est contre-indiqué
dans certaines affections cardio-vasculaires et en associant avec différents
médicaments utilisés dans l’angine de poitrine, surtout les
dérivés nitrés et les médicaments agissant sur
la libération du monoxyde d’azote. Il peut parfois provoquer des maux
de tête, une congestion nasale, des troubles digestifs et des douleurs
musculaires.
. vardénafil
(Levitra®), inhibiteur de la la phosphodiestérase. Il est disponible
en comprimés de 5, 10 ou 20 mg et la posologie ne doit pas dépasser
un comprimé par jour. La posologie habituelle est de 10 mg par prise.
Il agit par prise orale dès la première demi-heure et a une
demi-vie de 4 à 5 heures. Comme le Viagra®, il est contre-indiqué
dans certaines affections cardio-vasculaires et en associant avec différents
médicaments utilisés dans l’angine de poitrine, surtout les
dérivés nitrés. Il est également contre-indiqué
en association avec les puissants inhibiteurs du CYP3A4. Il peut parfois provoquer
des maux de tête, une congestion nasale, des troubles digestifs. (côut
d’environ 10 euros le comprimé, non remboursé par la sécurité
sociale).
. avafanil (Spedra®),
dernier inhibiteur de la la phosphodiestérase. Existe en dosage 100
et 200 mg avec un effet dans les 30 à 45 mn après l'absorption
et une demi vie de 6 à 17 heures.
. le chlorhydrate d’apomorphine
(Uprima® ou Ixense®). Son action se situe au niveau du système
nerveux central (hypothalamus) par un effet dopaminergique. Il agit environ
20 mn après la prise qui est sub-linguale (laisser se dissoudre le
comprimé sous la langue). Comme le sildénafil, il facilite l’érection
mais ne peut suffire à la déclencher. La posologie habituelle
est d’un comprimé de 3 mg et il est disponible par 2, 4 ou 8 cp non
remboursés par la sécurité sociale également.
. à part : le traitement
androgénique (testostérone) dont le but est de restaurer une
testostéronémie normale lorsqu’elle est trop basse. Ce traitement
pouvant avoir des effets secondaires prostatiques, hépatiques notamment,
doit être prescrit sous stricte surveillance. Exemples : Androtardyl
injectable®, Pantestone® par voie orale ou Androgel® par voie
trans-cutanée.
Sommaire
LE
VACUUM :
. système qui consiste à mettre la verge dans un cylindre que
l’on met en dépression par une pompe aspirante. Une fois les corps caverneux
gorgés de sang du fait de cette dépression, un anneau élastique
est placé à la racine de la verge et bloque le sang caverneux,
maintenant la tumescence. Le cylindre est alors ôté.
. l’anneau ne doit pas être laissé plus de 30
minutes pour limiter le temps d’ischémie du tissu caverneux.
. ce système est parfois inconfortable car responsable
de douleurs, d’écchymoses ou hématomes, d’une bascule de la verge
qui est « articulée » sur l’anneau élastique, d’un
blocage de l’éjaculat dans l’urètre.
Sommaire
PSYCHOTHERAPIE
ET SEXOTHERAPIE
Surtout dans les dysérections psychogènes et pour des patients
motivés par ce type de prise en charge, elle se fait souvent en associant
la partenaire à un moment ou à un autre.
Sommaire
TRAITEMENT
CHIRURGICAL
. revascularisation artérielle, d’indications exceptionnelles en dehors
de la chirurgie des gros vaisseaux.
. prothèses péniennes : une prothèse cylindrique est
mise en place dans les corps caverneux, à la place du tissu érectile,
le détruisant ainsi définitivement. C’est donc un traitement
irréversible et définitif, de dernière intention. Les
prothèses peuvent être rigides, semi-rigides, ou gonflables avec
un réservoir placé dans l’abdomen et une pompe placée
dans le scrotum. Le risque principal est infectieux, mais il existe également
des risques d’érosion, de dysfonctionnement pour les prothèses
gonflables pouvant nécessiter plusieurs réinterventions.
Sommaire
CONCLUSIONS
Le traitement des insuffisances érectiles a donc connu une évolution
importante ces dernières années.
Il n'en demeure pas moins que le résultat dépend
de la qualité de la prise en charge globale initiale et de la motivation
du patient.
ILLUSTRATIONS
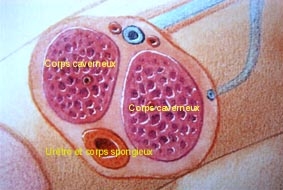 |
 |
|
Coupe transversale de la verge |
Auto-injection intra-caverneuse (exemple de matériel) |
 |
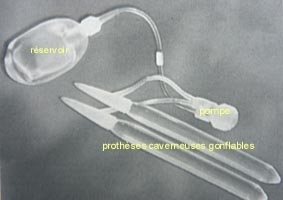
|
|
Exemple de Vacuum |
Exemple de prothèses péniennes gonflables
|
|
|
|
|
Sommaire
Docteur
B. d'ACREMONT - Mise à jour 31 janvier 2016