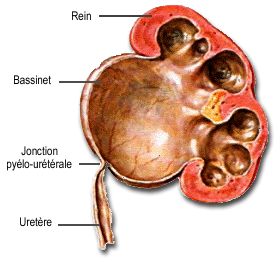
Syndrome
de jonction pyélo-urétérale
Sommaire
Rappels
anatomiques
Technique
Au réveil
Complications per-opératoires
Complications post-opératoires
Risques à distance
Précautions à prendre
RAPPELS ANATOMIQUES ET PATHOLOGIQUES
En principe il existe deux reins, chacun situé en arrière
de la cavité abdominale, en avant des derniers côtes et de chaque
côté de la colonne vertébrale.
Les reins
ont un rôle de filtration et élimination de déchets de l'organisme.
Cette fonction se fait en produisant de l'urine. Dans chacun des rein, l'urine
fabriquée par chacune des unités fonctionnelles du rein (néphrons)
est collectée par l'intermédiaire des calices puis tiges calicielles
dans le bassinet (ou pyélon) pour progresser ensuite dans l'uretère,
canal musculaire qui fait parvenir l'urine jusqu'à la vessie ou elle
est stockée entre deux mictions.
Le syndrome de jonction ou maladie
de jonction, correspondant à un rétrécissement de la
jonction entre le bassinet et l'uretère. Le rétrécissement
de la jonction entraîne une dilatation du bassinet, et ensuite des calices:
on parle alors d'hydronéphrose. Cette dilatation peut entraîner
des douleurs ou parfois des coliques néphrétiques.
Il peut être congénital et souvent
de nos jours diagnostiqué in utéro, mais parfois acquis ou n'apparaissant
que plus tardivement. Il atteint les deux sexes.
Il peut être lié à l'existence
d'un vaisseau anormal venant croiser la jonction qui vient alors basculer sur
lui, ou être lié à une fibrose de la jonction.
Négligé, il peut parfois aboutir
à une destruction du rein, se compliquer d'infection, et entrainer des
douleurs.
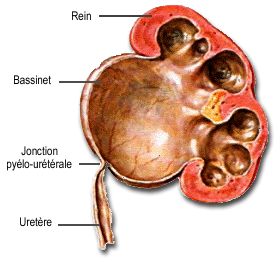 |
| Syndrome
de jonction pyélo-urétérale |
Le traitement du syndrome de jonction consiste à rétablir
un passage normal de l'urine entre le bassinet et l'uretère. L'intervention
de référence est la pyéloplastie ou résection-anastomose
de la jonction. Il existe également d'autres techniques par voie endoscopique
(dilatation au ballonnet, incision endoscopique par Acusise ou par voie per-cutanée)
mais dont les résultats sont moins bons que la pyéloplastie en
première intention. Ces dernières techniques peuvent être
utilisées dans certains cas particulier, plus souvent en seconde intention.
Comme avant chaque intervention, une consultation
d'anesthésie est nécessaire dans le mois qui précède
l'intervention. La stérilité des urines sera vérifiée
par un examen cytobactériologique des urines quelques jours avant l'intervention.
Un régime sans résidu pourra vous être demandé quelques
jours avant l'intervention pour diminuer le volume de votre colon et améliorer
la vision du chirurgien pendant l'intervention.
Cette intervention se déroule sous anesthésie
générale et peut se faire soit par une incision lombaire ou postérieure,
soit par coelioscopie. Le choix entre ces voies d’abord se fait en fonction
de vos antécédents, du type de rétrécissement, de
votre morphologie, des habitudes de l’opérateur. Une ou deux voies
d'abord veineuses sont mises en place avant le début de l'intervention
ainsi qu'une sonde vésicale. Cette sonde vésicale est mise en
place pendant l'anesthésie, pour éviter de mettre sous tension
la suture et éviter d'avoir des difficultés urinaires au réveil.
La coelioscopie ne modifie pas le principe de
l’opération. La coelioscopie consiste à opérer sous
anesthésie générale, sous écran vidéo par
l’intermédiaire d’une caméra fixée à
un optique. Cet optique et les instruments du chirurgien sont amenés
au site opératoire après ponction de la paroi abdominale au travers
de tubes appelés trocarts. Pour pouvoir travailler, l’opérateur
doit gonfler la région ou se situe l’intervention, à l’aide
d’un gaz inerte (gaz carbonique : CO2). Les avantages de ce type d’intervention
sont essentiellement représentés par la simplicité des
suites opératoires, la diminution de la durée de convalescence
et la réalisation de cicatrices de plus petite taille que par chirurgie
conventionnelle.
Le plus souvent, la jonction pyélo-urétérale
est enlevée et le circuit des urines est rétablit en effectuant
une suture entre le bassinet et l'uretère. En cours d'intervention une
sonde est placée à travers cette suture, soit totalement interne
allant du bassinet à la vessie (sonde JJ ou endo-prothèse urétérale)
et qui sera retirée quelques semaines plus tard par les voies naturelles
lors d'une cystoscopie en consultation, soit sortant à travers la peau
et destinées à être retirée quelques jours après
l'intervention.
Un ou plusieurs drains peuvent également
être laissés en place en fin d'intervention pour évacuer
et surveiller les éventuels écoulements post-opératoires.
En fin d'intervention, le patient est transféré
en salle de réveil avec une ou deux perfusions, un drainage par un ou
deux drains aspiratifs.
La sonde vésicale est ôtée
quelques jours après l'intervention. Les drains seront ôtés
dans des délais variables selon les quantités de liquide évacués.
En général, leur ablation se fait entre 2 à 5 jours suivant
l'intervention.
Pendant l'intervention:
- hémorragie:
il peut survenir par blessure d'un vaisseau. L'importance de ce saignement peut
nécessiter une transfusion de sang ou de dérivés sanguins,
avec un risque certes très faible mais toujours possible d'infection
(hépatite, HIV, prions ?,..). Exceptionnellement, un saignement incontrôlable
peut survenir et entraîner un décès lors de l'intervention.
- Blessure des organes voisins: rate, foie, pancréas, intestin,…
Ces blessures pourront entraîner un geste complémentaire lors de
l'intervention: ablation de la rare, suture intestinale, hépatique,..
- Impossibilité de pouvoir réaliser l'intervention du fait de
difficultés anatomiques ; dans ce cas le chirurgien peut prendre la décision
de modifier l'intervention, d'intervention par une incision plus grande, voire
d'enlever le rein dans certaines situations compliquées.
- Compressions nerveuses ou des zones d'appuis pendant l'intervention: fesses,
épaule, hanches. Exceptionnellement, un étirement d'un nerf ou
groupe de nerf peut entraîner une paralysie dont la récupération
peut être incomplète (plexus brachial par exemple). Ces compressions
ou étirements sont au maximum prévenues pendant l'intervention
par la mise en place de coussins, la vérification des zones d'appuis
et de contact du patient avec la table d'opération et ces accessoires.
- comme pour tout acte chirurgical, certaines complications imprévisibles
parfois mortelles peuvent s'observer tenant à des variations individuelles
parfois imprévisibles, à l'âge, à la pathologie présentée.
Lors de l'intervention un évènement ou des constatations imprévues
pourront modifier le déroulement de l'intervention et faire envisager
un ou plusieurs gestes non prévus initialement.
-
hémorragie abondante: elle peut alors nécessiter une nouvelle
intervention en urgence pour stopper le saignement.
- infection de la cicatrice opératoire, rares, elle est traitée
en retirant quelques points ou agrafes afin de vider un hématome ou un
abcès, éventuellement par la mise en place de drains, par un traitement
antibiotique. Le risque d'infection est minimisé en demandant au patient
de se doucher avec un antiseptique avant d'être amené au bloc opératoire,
par la prescription lors de l'intervention d'un traitement antibiotique préventif
(antibioprophylaxie).
- fistule urinaire due à une mauvaise cicatrisation de la voie excrétrice,
à l'origine d'un écoulement d'urines dans l'abdomen, par le drainage
de paroi ou par la cicatrice. Cet écoulement pourra parfois nécessiter
la mise en place d'une sonde urétérale pour assécher la
fistule, plus rarement une nouvelle intervention pour refermer la voie excrétrice,
voire enlever le rein.
- péritonite très rarement: elle impose dans ce cas une réintervention
pour drainer le péritoine, traiter la cause qui peut être une plaie
intestinale, pancréatique méconnue pendant l'intervention.
- Infections nosocomiales: infections à certains germes, souvent résistants,
contractées à l'hôpital. Ces infections peuvent intéresser
le site opératoire, le reste de l'appareil urinaire, les poumons, les
cathéters intra-veineux,… Le taux d'infection nosocomiale est globalement
de l'ordre de 6 à 7 % tous services et toute pathologie confondue (enquête
de prévalence sur une journée en 1996).
- thrombose veineuse: phlébite avec un risque d'embolie pulmonaire parfois
massive et mortelle. Ce risque justifie parfois selon vos antécédents,
la prescription d'un traitement anti-coagulant préventif, le port de
bas de contention veineuse des membres inférieurs, une mobilisation précoce
(l'alitement prolongé étant défavorable).
- occlusion intestinale: souvent réflexe, parfois favorisée par
la prise d'antalgiques morphiniques, due à une paralysie transitoire
du péristaltisme intestinal entraînée par l'ouverture du
péritoine elle régresse alors en quelques jours et nécessite
seulement de différer la réalimentation jusqu'à la reprise
du transit intestinal. Parfois elle est liée à l'apparition d'accolements
(brides) entre les anses intestinales et peut dans ce cas survenir des années
plus tard. Si l'occlusion persiste malgré le jeun, la mise en place d'une
sonde gastrique, une intervention s'impose pour supprimer les accolements responsables
mais le risque de voir de nouveaux accolements se faire à distance demeure.
- troubles de la sensibilité et douleurs cicatricielles (névralgies):
liés à la section de petits rameaux nerveux sur le trajet des
trocarts, à la tractions des cicatrices sur des nerfs , à la repousse
anormale de nerfs sectionnés (névromes). Ils peuvent parfois demander
une intervention.
- Plus spécifique à la coelioscopie :
o douleurs des épaules par irritation
du diaphragme, justifiant l’évacuation soigneuse du gaz en fin
d’intervention.
o emphysème sous-cutané, rarement
à préoccupant.
o éventrations sur un orifice de trocarts.
Elles seront prévenues par la fermeture des aponévroses en fin
d’intervention au niveau des gros trocarts.
o syndrome de loge par un appui anormal et prolongé
des muscles des membres inférieurs essentiellement, entraînant
une compression musculaire puis un oedème de ces muscles dans leur gaine.
Exceptionnellement, il peut être nécessaire d'inciser en urgence
des gaines aponévrotiques pour éviter que cet oedème n'empêche
la vascularisation de ces muscles et n'aboutisse en une nécrose de ceux-ci.
Comme dans toute intervention abdominale, des déformations
de la paroi de l'abdomen, plus ou moins importantes, et des brides intra-abdominales
peuvent survenir.
Un rétrécissement de l'anastomose
pyélo-urétérale peut survenir plus à distance et
justifie une surveillance régulière par échographie et
si un doute apparaît sur une resténose par urographie intra-veineuse
ou uroscanner. Une récidive de la sténose pourra nécessiter
une nouvelle intervention par voie chirurgicale ou endoscopique.
Après la sortie, il est nécessaire pour permettre
une bonne cicatrisation de la paroi d'éviter tout effort physique anormal
pendant 1 mois.
Il n'est pas nécessaire d'envisager un
quelconque régime mais le maintien d'apports hydriques suffisants est
important (une bouteille d'eau par jour).
Si une sonde JJ a été mise en place,
son retrait est habituellement
effectué un mois après l'intervention, en consultation sous anesthésie
locale, par voie naturelle en réalisation une fibroscopie vésicale.
Télécharger la fiche d'information de l' AFU
Docteur B. d'ACREMONT - Mise à jour le 29 décembre 2014